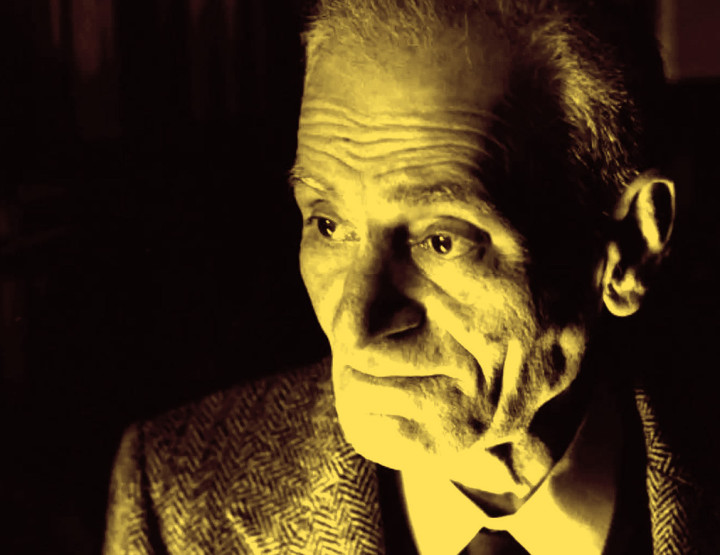« La voix du silence,
l’art ne peut être la reproduction exacte de la nature »
« Les phares », où la recherche du romantisme perdu, installe L’Œil de Baudelaire dans un paysage mental qui n’est autre qu’une évocation picturale qui fixe dans le réel, les images de sa propre poésie. À bien des égards, cette exposition retrace le fil de ses observations, filiation non exhaustive de ses recherches, de ses choix artistiques, de ses rencontres, de ses critiques, comme pour interroger dans l’œuvre du poète les relations entre l’art et la couleur, entre la forme et l’art, entre la caricature et la photographie, au travers de la littérature, mais aussi de sa propre image. Témoignage par Nadar d’une admiration, une présence singulière, qui comme Baudelaire en son temps fut marqué de sa vision, l’importance d’un Delacroix, offrant à nos yeux et pour l’histoire :
« …le meilleur témoignage.
Que nous puissions donner de notre dignité
Que cet ardent sanglot qui roule d’âge en âge,
Et vient mourir au bord de votre éternité !… » – « Les phares »
C’est au salon de 1846 que Baudelaire apparaît comme critique d’art, pour devenir au 19e siècle un poète reconnu et au 20e siècle un écrivain et critique d’art. Pourtant, comme le souligne Mathilde Labbé :
« Rien d’étonnant à la distinction de plusieurs moments, à l’identification de la critique d’art en tant que telle. Ce qui étonne davantage, c’est la promotion de ces écrits au rang de modèle, alors même que Baudelaire était contemporain de critiques d’art influents comme Étienne-Jean Delécluze, Gustave Planche ou Théophile Thoré-Burger. Cette relecture ne s’éclaire qu’une fois replacée au sein de la question plus large des rapports de la critique d’art avec la littérature, c’est-à-dire par une analyse conjointe des évolutions du genre de la critique d’art des rapports entre la littérature et l’histoire de l’art et des conflits de légitimité qui opposent artistes et professionnels… Le deuxième moment de la réception de l’œuvre de Baudelaire en tant que critique d’art commence au cinquantenaire de sa mort. Son œuvre connaît un fort retentissement dans les cercles artistiques. Émile Bernard, l’un de ses illustrateurs, écrit en 1919 le premier essai sur la question. Durant l’entre-deux guerres, les écrivains critiques s’intéressent à leur tour aux essais sur l’art de Baudelaire. Pour Malraux, en 1948, il est le plus grand esthéticien de la littérature française. Ministre d’État aux Affaires Culturelles, il fait de 1967 une année de Baudelaire. Pour Reverdy, il a inventé la critique. »
Pour autant, en apprend-on plus sur le fond de ses critiques ? Ce ne sera pas le lieu pour cette découverte, entre l’œil et les mots il y a somme toute une distance qui ne nous est pas dévoilée. La Bibliothèque nationale de France est sans doute un lieu plus approprié aux liens textuels, imaginaires de l’auteur entre l’art observé, ses notes, ses recherches et « Les Fleurs du mal » comme des :
« … yeux, où rien ne se révèle
De doux ni d’amer,
Sont deux bijoux froids où se mêle
L’or avec le fer. » – « Le serpent qui danse »
Car, en vérité, le romantisme n’est précisément ni dans le choix des sujets ni dans la vérité exacte, mais dans l’intimité des mille manières de ressentir « la spiritualité, la couleur, aspiration vers l’infini, exprimée par tous les moyens que contiennent les arts ».
L’amour, l’abandon aux corps sous toutes ses formes, la jouissance féconde et sans entrave, somme de toutes les muses. N’est-il pas l’objet de toutes les passions exprimées par la beauté des hommes et des femmes à toutes les époques où ils jouissaient ensemble sans mensonge et sans anxiété ? Comme Charlotte Manzini nous le rappelle dans le catalogue de l’exposition :
« Au début du Salon de 1846, juste après le quatrième chapitre consacré à Delacroix, il interrompt aussi brusquement le compte rendu des œuvres exposées au Louvre pour interpeller son lecteur et lui confesser qu’il rêve d’un musée idéal, où se trouveraient réunis non seulement tous les tableaux qui traitent spécialement de l’amour, mais encore ceux qui respirent l’amour, fut-ce un portrait. L’amour étant la seule chose qui vaille la peine de tourner un sonnet et de mettre du linge fin. »
Ces figures picturales offraient au poète les toiles, les couleurs, les histoires de ses rêveries fécondes : « poème immense de l’amour crayonné par les mains des plus pures ».
Dans une salle dominée par « La Nymphe au scorpion » de Lorenzo Bartolini, les commissaires de l’exposition ont recréé le musée de l’amour imaginé par Baudelaire pendant le Salon de 1846 et dominé par l’art de Constantin Guys :
« Un musée de l’amour où tout aurait sa place, depuis la tendresse inappliquée de Sainte Thérèse jusqu’aux débauches sérieuses des siècles ennuyés ».
On y découvrira « La Grande Odalisque » (tête) – 1814 ; « La Nymphe couchée » de Nicolas-François-Octave Tassaert ; des lithographies coloriées anonymes (« Sans chemise, ça collera mieux », « Les Jets d’eau ») ; les « Femmes d’Alger dans leur appartement » d’Eugène Delacroix – 1834 ; « La Mort de Sapho » de Charles Dugasseau – 1842 ; « Rêverie d’Hippolyte Flandrin » – 1841… Aux côtés de Baudelaire, cette exposition explore aussi les mutations qui s’opèrent entre romantisme et impressionnisme en présentant, autour des artistes de l’époque– Eugène Delacroix, Jean-Auguste-Dominique Ingres, Jean-Baptiste Camille Corot, Théodore Rousseau, Théodore Chassériau, George Catlin, Alphonse Legros, Octave Penguilly L’Haridon. Mais aussi l’apparition de la lithographie au début du 19e siècle qui permet l’essor d’une importante production d’estampes érotiques, et satiriques avec Honoré Daumier, Francisco Goya, Paul Gavarni, ouvrant ainsi la voie sur une réflexion de la peinture moderne, c’est-à-dire urbaine, triviale et politique ; mais aussi sur l’enjeu de la modernité que forge le poète face à ce nouveau Paris qu’il ne reconnaît plus :
« Avant de chercher quel peut être le côté épique de la vie moderne, et de prouver par des exemples que notre époque n’est pas moins féconde que les anciennes en motifs sublimes, on peut affirmer que puisque tous les siècles et tous les peuples ont eu leur beauté, nous avons inévitablement la nôtre. Cela est dans l’ordre. Toutes les beautés contiennent, comme tous les phénomènes possibles, quelque chose d’éternel et quelque chose de transitoire – d’absolu et de particulier. La beauté absolue et éternelle n’existe pas, ou plutôt elle n’est qu’une abstraction écrémée à la surface générale des beautés diverses. L’élément particulier de chaque beauté vient des passions, et comme nous avons nos passions particulières, nous avons notre beauté… La vie parisienne est féconde en sujet poétique et merveilleux. Le merveilleux nous enveloppe et nous abreuve comme l’atmosphère ; mais nous ne le voyons pas. Le nu, cette chose si chère aux artistes, cet élément nécessaire de succès, est aussi fréquent et aussi nécessaire que dans la vie ancienne : – au lit, au bain, à l’amphithéâtre. Les moyens et les motifs de la peinture sont également abondants et variés ; mais il y a un élément nouveau qui est la beauté moderne. »
Aux nouveaux langages artistiques en formation, incarnés par la génération montante et la figure d’Édouard Manet, il y a la photographie, éléments du monde moderne, cette « grande folie industrielle » et Nadar. Avant de se lier d’amitié́ avec Baudelaire, Édouard Manet fit partie de ses créanciers. Mais pour Baudelaire, Manet n’a pas la trempe d’un Delacroix et si il loue son talent, il ne loue pas son génie. Quand au moment où Olympia, fait scandale au Salon de 1865, le poète ne prit pas la plume pour défendre son ami et la formule qu’il lui adresse dans une célèbre lettre deviendra célèbre et à de nombreuses interprétations : « vous n’êtes que le premier dans la décrépitude de votre art.»
Dans ses Notes nouvelles sur Edgar Poe, il qualifiera le progrès de « grande hérésie de la décrépitude ». Une façon de dire probablement que d’autres l’on été avant lui, « en un temps où l’art était grand ; vous êtes le premier à l’être dans cet état de l’art qui est caractérisé par la foi du progrès, c’est-à-dire par la décrépitude. »
Baudelaire entretient une relation paradoxale avec la photographie :
« Une antithèse de l’art, instrument de la perte de l’idéal… S’il est permis à la photographie de suppléer l’art dans quelques-unes de ses fonctions, elle l’aura bientôt supplanté ou corrompu tout à fait, grâce à̀ l’alliance qu’elle trouvera dans la sottise de la multitude. Il faut donc qu’elle rentre dans son véritable devoir, qui est d’être la servante des sciences et des arts, mais la très humble servante, comme l’imprimerie et la sténographie, qui n’ont ni créé ni suppléé́ la littérature. […] S’il lui est permis d’empiéter sur le domaine de l’impalpable et de l’imaginaire, sur tout ce qui ne vaut que parce que l’homme y ajoute de son âme, alors malheur à nous ! L’artiste, en un mot, devient une machine attelée à une autre machine… C’est l’imagination qui a enseigné́ à̀ l’homme le sens moral de la couleur, du contour, du son et du parfum… De jour en jour l’art diminue le respect de lui-même, se prosterne devant la réalité́ extérieure, et le peintre devient de plus en plus enclin à peindre, non pas ce qu’il rêve, mais ce qu’il voit. Cependant, c’est un bonheur de rêver, et c’était une gloire d’exprimer ce qu’on rêvait. »
Quatre portraits de Baudelaire par Nadar sont aujourd’hui connus. Il y en a un qui est particulièrement intéressant, « Charles Baudelaire au fauteuil » par Nadar, vers 1855 car si on y regarde de plus près, on ne peut que penser au portrait de « Madeleine dans le désert » d’Eugène Delacroix, 1845. Œuvre préférée de Baudelaire, lien d’attachement des trois artistes, Delacroix, Baudelaire et Nadar à un idéal commun, ambiguïté et la complexité des passions humaines réunis : « Nul à moins de la voir ne peut imaginer ce que l’artiste a mis de poésie intime, mystérieuse et romantique dans cette simple tête. C’est que Monsieur Delacroix est plus fort que jamais et dans une voie de progrès sans cesse renaissante, c’est-à-dire qu’il n’est plus que jamais harmoniste » – Charles Baudelaire, critique du Salon de 1845.
Baudelaire se montre alors dans sa vérité physique et sensible, entre la vie des extases et rêveries. Propice à la distance, entre séduction et abandon à la vie. La boucle est bouclée, la postérité ne se vit qu’au prix d’un désert brûlant et solitaire. Une âme errante entre idéal et soif de vivre pour l’éternité !
La mort à son image, nous autres pèlerins, nous aurons ses textes, ses mots, sa littérature sur le chevet de nos blessures, de nos amours…
Cette exposition attachante, intime, sous la grisaille d’un Paris qui se cherche un nouveau souffle dans le continuum de la modernité ; vous fera rêver et transporter dans l’œil des arts, au contour flottant de la pupille d’un homme, en explorant toile après toile, l’univers des mutations esthétiques, techniques dont Baudelaire a été le témoin critique de son temps.
Tout en regardant la nuit dans un « chagrin d’enfant », briller le verbe « aimer », tout en montrant l´ennui d’un attachement indéfectible au romantisme qui sut inclure au présent bien qu´il fût au passé, son grand peintre Eugène « Delacroix…
… lac de sang hanté de mauvais anges,
Ombragé par un bois de sapins toujours vert,
Où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges
Passent, comme un soupir étouffé de Weber ;
Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes,
Ces extases, ces cris, ces pleurs, ces Te Deum,
Sont un écho redit par mille labyrinthes ;
C’est pour les cœurs mortels un divin opium ! … » – « Les phares »
Un divin opium, oui, il s’agit bien de cela !
(« L’œil de Baudelaire » au musée de la Vie romantique, du 20 septembre 2016 au 29 janvier 2017, http://www.vie-romantique.paris.fr/fr)