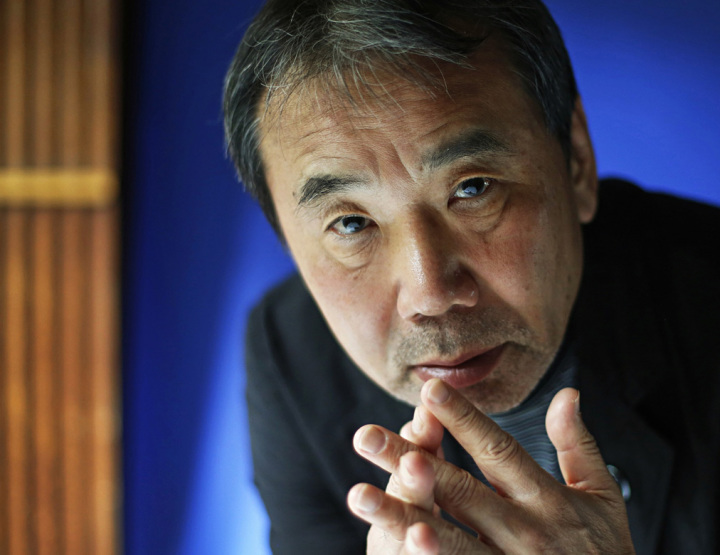« Ce n’est pas si facile d’écrire sur rien. »
Les différents tableaux défilant ont la valeur de ses innombrables décalages horaires, c’est-à-dire décalés et hors du temps : « ni passé ni futur mais seulement un perpétuel présent qui contient cette trinité du souvenir… Comme une pelote de fil en mouvement ». L’écrivain, en chef d’orchestre, sait trouver dans le détail, la mise en forme d’une narration subjective à partir d’une chronologie asymétrique, en fixant son récit par la beauté des images ; sous le regard des disparus, par des textes et photographies confondus, comme une légende visuelle à l’imaginaire, comme une fenêtre somnambulique aux mots.
« Il faisait très froid et de nouveau le ciel s’est assombri. Je me sentais étrangement détachée, engourdie, et pourtant visuellement en phase. Attirée par le contraste des ombres, j’ai pris quatre photographies du porte encens. Elles étaient similaires, mais elles me plaisaient, je les imaginais comme panneaux d’un paravent. Quatre panneaux, une saison. Je me suis inclinée en remerciant Akutagawa tandis qu’Ace et Dice se dépêchaient de retourner à la voiture. Pendant que je leur emboîtais le pas, le soleil capricieux est revenu. Je suis passée devant un très vieux cerisier emmailloté dans de la toile effilochée. La lumière froide donnait de la profondeur à la texture autour du tronc et j’ai effectué le cadrage de ma dernière prise de vue : un masque comique dont les larmes fantomatiques semblaient rayer les fils abîmés de la toile. »
L’auteur sait regarder l’intranquillité du monde à travers son monde pour n’en faire qu’un : le Monde, comme M de « M Train ». Pour Patti Smith, l’écriture de son livre revient à figer l’image du récit par un entrelacement à proportions égales du temps écoulé et du temps présent, comme une porte ouverte au spleen. Un monde visible qui représente un exil, celui des destructions et de la solitude, celui d’un monde invisible, salvateur, pour qui sait comprendre l’unité profonde de l’univers.
« J’avais un manteau noir. Un poète me l’a offert il y a des années, pour mon cinquante-septième anniversaire… Chaque fois que je l’enfilais, j’avais l’impression d’être moi-même. Les mites aussi l’appréciaient et il était criblé de petits trous le long de l’ourlet, mais cela m’était égal. Les poches s’étaient décousues et je perdais tout ce que je fourrais par inadvertance dans leurs saintes grottes. Chaque matin, je me levais, mettais mon manteau et mon bonnet, j’attrapais mon stylo et mon carnet et je traversais la Sixième Avenue pour aller dans mon café. J’adorais mon manteau, le café et ma routine matinale. C’était l’expression la plus claire et la plus simple de mon identité solitaire… Mon manteau noir s’est volatilisé, évanoui, telle la précieuse chevalière qui disparaît du doigt du croyant fautif dans « Le voyage en Orient » de Hermann Hesse. Je continue de chercher partout en vain, espérant qu’il va apparaître comme des grains de poussière illuminés par la soudaine lumière. Puis, non sans honte, dans mon deuil infantile, je pense à Bruno Schulz, piégé dans le ghetto juif de Pologne, remettant à l’humanité la seule chose précieuse qui lui restait : le manuscrit du Messie. L’ultime œuvre de Bruno Schulz engloutie dans la fange des derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, inatteignable. Choses disparues. Elles griffent à travers les membranes, tentent de capter notre attention par d’indéchiffrables SOS. Les mots dégringolent désespérément dans le désordre. Les morts parlent. Nous ne savons plus écouter. »
« Ce n’est pas que les morts ne parlent pas, disait Pasolini. C’est qu’on a oublié comment les écouter. »
Vivre dans l’intimité de l’auteur, c’est comme vivre en transparence, ce que la feuille polarisée perçoit quand traverse la lumière de l’absence, c’est vivre davantage, car rien n’interrompt l’amour des êtres éloignés, l’amour est là, il ne meurt jamais. Les images ont leur façon à elles de se dissiper puis de se « re-rêvéler » brutalement, ramenant avec elles la joie et la douleur, la couleur vive du passé, en une révélation chimique, telle une flamme vacillante qui reste à l’intérieur de soi. Comme un mouvement introspectif au travers de sa propre mémoire, en sélectionnant de modestes moments de sa vie, comme les morceaux de verres cassés jonchant le sol avec les fleurs mortes de ses amours. C’est revenir à ce qui est la colonne vertébrale d’un être et non de son visage qu’elle donne à voir, qu’elle perçoit entre deux vagues, entre deux bourrasques, frappée par la pluie des événements et qui finit par masquer les larmes du manque et de la solitude, du temps qui passe !
« Ce que j’ai perdu, je me le remémore. Ce que je ne peux voir, je tente de l’appeler. Je me fie à mes impulsions, à la lisière de l’illumination… On peut tolérer un monde de démons pour l’amour d’un ange… Il suffit alors d’avoir des pensées agréables. »
Pourquoi faut-il que nous soyons en relation avec certains êtres, certaines écritures, certains lieux, avec certains objets ? Pourquoi faut-il que nos possessions pleurent-elles de nous avoir perdus ? L’expérience humaine ne fait que tisser l’étoffe de son linceul, jusqu’au défilement à l’envers pour retrouver son étrange Talisman, une Toison d’or, au puits de l’humanité, tel le Tout-Puissant, un Cow-boy, « un agneau ouvrant les yeux aux nuages qui ressemblent un instant aux manteaux laineux de sa propre espèce ».
« M Train » est une sorte de cartographie des fragiles éclaboussures, « des mots empruntés à la voix off d’un rêve plus fascinant que la vie ». La marque d’un chemin absolu, parcouru sur le globe de l’existence, celle du passé, entre solitude, voyages, imaginaire, lectures, géographie, rencontres et le café à toute heure, à chaque instant, à chaque seconde. Élément moteur, essence même de la vie, venu d’une terre sensible, immergée, du recueillement, au nectar du souvenir. C’est avant tout un livre poétique sur le lien qui unit les êtres aimés qu’ils soient proches ou écrivains, quand ceux-ci ne sont plus. Brûlés dans le feu du cœur, nulle cendre sur le sol, à la source d’une vallée des disparus. Mais partagent chaque instant du jour et de la nuit, une chaleur de la compassion humaine, dans les yeux pâles d’une horloge sans aiguilles. Gardant jalousement, l’écriture, sur des feuilles volantes, un calepin Moleskine, des serviettes de café, au milieu desquelles sont enfouis, éparpillés, les êtres qui s’élèvent dans les bras de la lumière !
« Je suis certaine que je pourrais écrire indéfiniment sur rien. Si seulement je n’avais rien à dire… Pour moi, c’est comme respirer. C’est mon destin, mon heureuse malédiction… Tous les écrivains sont des clochards, ai-je murmuré. Puissé-je un jour être compté parmi vous. »
« On n’est jamais plus seul au monde que lorsqu’on attend d’être retrouvé. »
(« M Train » de Patti Smith, éditions Gallimard, traduit de l’anglais (USA) par Nicolas Richard, sortie avril 2016, 53 ill., 272 pages, 19,50€)