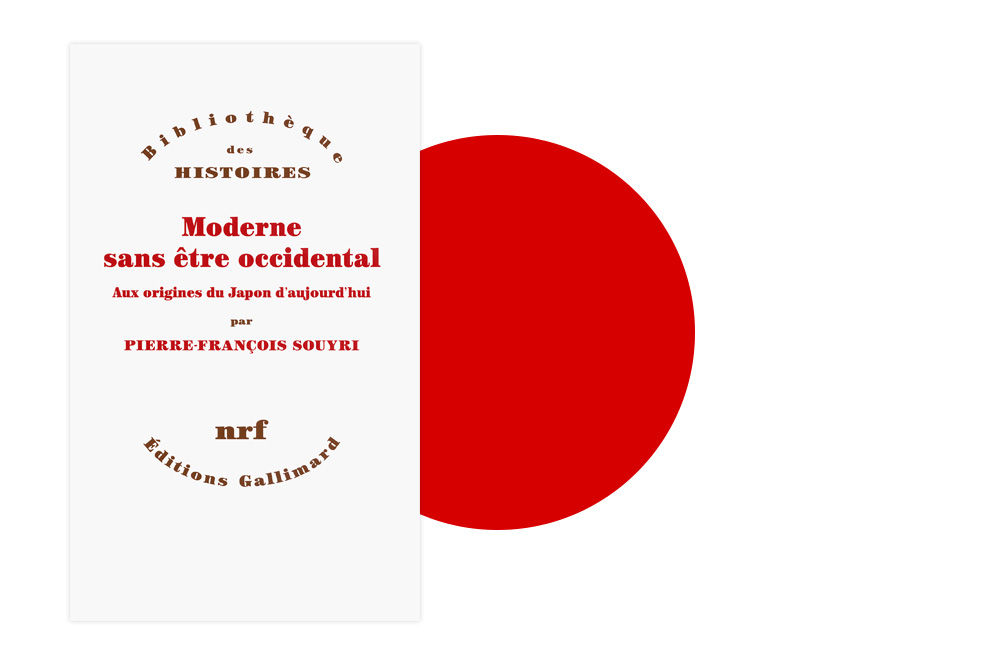L’histoire du Japon montre que la naissance au monde moderne ne fut pas simplement imposée de l’étranger, comme « revêtement superficiel, un ravalement extérieur, un barbouillage de façade », comme l’écrivit Shiga Shigetaka dans le manifeste de la nouvelle revue Nihonjin (1888). Mais vécut comme une construction à résister à une hégémonie culturelle, à une puissance militaire, grâce à un mouvement modernisateur issu des profondeurs de la société japonaise elle-même, accompagnant « la réforme des esprits » par différentes réformes administratives.
La modernité, une pensée universelle et mouvante !
« Dans Le Livre du thé, publié en 1906, le critique d’art Okakura Tenshin rappelait que le drame des relations entre l’Asie et l’Occident provenait des quiproquos et des mensonges que chacun des deux mondes entretenait sur l’autre. Pourtant, écrivait-il, ces idées fausses commencent à se dissiper… Les jeunes Asiatiques affluent vers les collèges occidentaux pour acquérir l’éducation moderne. Si nous n’approfondissons pas encore votre culture, du moins avons-nous la volonté de la connaître. Malheureusement, l’attitude occidentale est peu favorable à la compréhension de l’Orient. Le missionnaire chrétien vient chez nous pour enseigner et non pour apprendre… Quand donc l’Occident comprendra-t-il ou essaiera-t-il de comprendre l’Orient ? »
Les sociétés orientales relevaient alors du monde de l’immanence quand les nôtres se trouvaient contraintes d’admettre l’altérité alors qu’elles se figuraient elles-mêmes comme transcendantales. Si le concept de modernité est longtemps resté associé à l’histoire occidentale, dont elle prétendait avoir été le berceau, les temps des « Lumières », semblent être communs à chaque société dans leurs évolutions. Seul le temps de leurs éclosions permet d’arrêter sur l’échelle de l’Histoire, leurs scintillements, leurs présences dans l’humanité. Représentations au monde, contraction des enjeux extérieurs, volonté d’émancipation, sauvegarde des traditions originelles induites dans la relation au spirituel.
Mais ces notions ne posent-elles pas dans leur dogmatisme, la rigidité même, une vision purement occidentale ?
La Société de l’an VI, Club d’intellectuels et de hauts fonctionnaires, fondée six années après la rénovation de Meiji ne s’interdit aucun champ de réflexion qu’il soit institutionnel, religieux, ou du vivre ensemble… À de nombreux égards, elle prit la forme d’une occidentalisation, dans les manières de faire et de penser par les multiples agencements politiques singuliers qui, au Japon, ont vu le jour dès les années 1880, au début de l’ère Meiji (1867-1912). Éclatante singularité, où s’entremêlent la pensée traditionnelle, Confucius, les idées rousseauistes, les droits de la « personne humaine », l’individualisme naissant, et participent d’avantage à la construction de cette modernité qu’à l’Occidentalisation du pays.
L’auteur dresse l’image vivante d’un Japon où les lumières ancestrales, les grandes mutations, s’inscrivent dans un flux ininterrompu de cette transformation devenue nécessaire. Incarnant autant que l’Occident un esprit expansionniste mais à l’écart de celui-ci, une forme de résistance, en s’affirmant plus tard comme un Etat-Nation.
On croise dans l’ouvrage de nombreux intellectuels, à l’image du traducteur, journaliste et pionnier des modernisateurs, Fukuzawa Yukichi qui à la suite de plusieurs voyages, s’est nourri aux idées occidentales. La féministe Kishida Toshiko, quant à elle va puiser dans les sources du confucianisme les idées pour l’émancipation des femmes : « Ivre, je dors sur les genoux d’une jolie femme. Réveillé de mon ivresse, me voici prêt à prendre le pouvoir », voici comment se voyaient les samouraïs dans les années 1860. Elle utilisa pour parler de l’éducation des jeunes filles de bonne famille, l’expression qui restera célèbre hakoiti musume (fille élevée dans une boîte).
Selon Kishida, si « les hommes sont meilleurs que les femmes pour diriger le monde parce qu’ils sont plus forts, alors pourquoi n’y a-t-il pas de lutteurs de sumo au gouvernement ? » Dans un discours considéré au Japon comme le premier texte féminin sur l’égalité des droits et repris dans Jiyû no tomoshibi (La lumière de la liberté), le 17 juin 1884, elle terminait : « ô mes sœurs tant aimées, changeons les veilles habitudes, détruisons les coutumes néfastes, cessons de perdre la tête pour des hommes sans cœur. »
Ce qui s’est joué dans l’ensemble de ce processus est à mettre quasiment sur le même plan, que ce que l’Europe a vécu au même moment de son histoire. Dans le désir d’une aspiration révolutionnaire marquée par un système qui ne répondait pas aux aspirations de son peuple, qui devait s’adapter à l’évolution permanente de son économie et aux nouvelles revendications pour les droits. Pour Souyri, Nakae Chômin fut un de ses « partisans de la liberté. Fils d’un modeste samouraï, il put néanmoins séjourner en France pendant trois ans et lire Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Victor Hugo. Il se lança dans la traduction du Contrat social de Rousseau, qui le fit connaître dans les différents mouvements démocratiques. Puis vient, l’écriture des Trois Ivrognes, un essai, une réflexion politique, dans lequel il expose, argumente les tensions et les enjeux des différents courants en lutte dans un Japon partagé sans cesse par l’attrait pour la nouveauté et la nostalgie du passé.
Nul n’a le monopole de l’histoire, uniquement des contours multiples qui se dessinent, complexes, mouvants, qui s’entrecroisent et se chevauchent parfois. Figures et grammaire que nous d’écrit l’auteur dans son enseignement. « L’âme japonaise » ou la question fondamentale de la construction de son influence, du refus, entre classicisme, modernité, droit des peuples et l’état nation est sans doute à comprendre dans sa contradiction, sa capacité à faire entendre ses différences qu’elle suscite et non dans le reflet de phénomènes de distorsions que l’on peut observer à la surface de ses échos.
Enfin, comme en réponse à nos histoires contemporaines troublées, Pierre-François Souyri revient sur les mécanismes idéologiques, d’où prennent racine les idées impérialistes, le développement du militarisme et du patriotisme qui les accompagne. Les années 1890 constituent alors un tournant : « La gloire de l’Occident, c’est l’humiliation de l’Orient », écrivait Okakura Tenshin. De son côté, Uchimaru Kanzô favorable dans un premier temps à la « guerre juste » à la veille de la guerre sino-japonaise, écrit en 1911 :
« La guerre n’a jamais arrêté la guerre, elle ne fait que l’engendrer… Il n’y a pas de plus grande illusion que de croire que les armes sont les garantes de la paix. Les armes ne garantissent pas la paix. Elles garantissent la guerre ».
En somme, le Japon a avancé de concert avec l’histoire de la modernité occidentale mais en créant sa propre histoire.
(« Moderne sans être occidental. Aux origines du Japon aujourd’hui » de Pierre-François Souyri, éditions Gallimard, sortie 11 mai 2016, 496 pages, 25€)