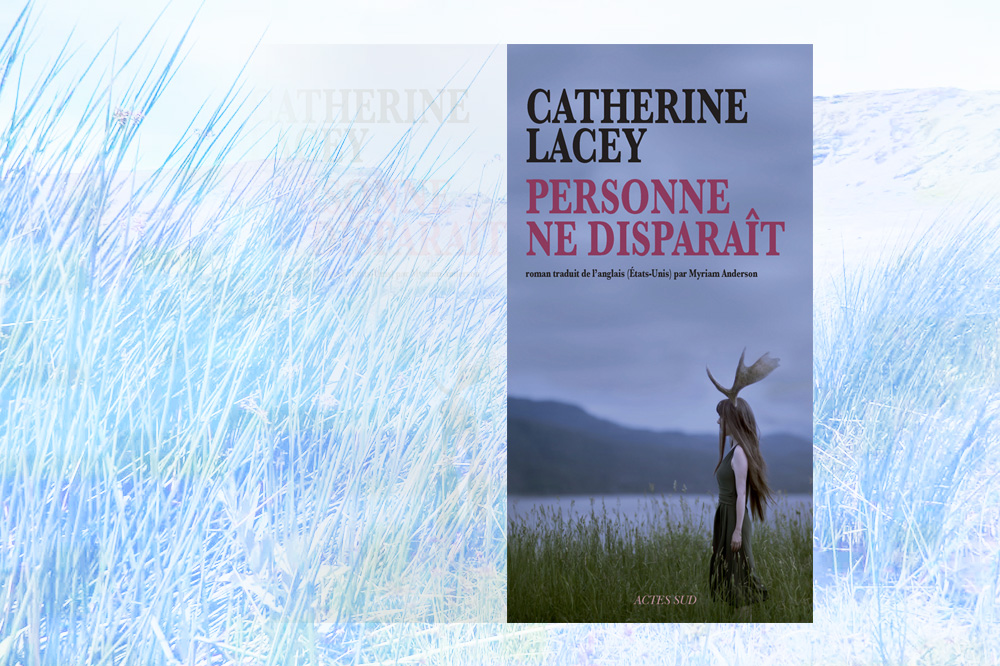Un roman d’une apparence indifférente, celle d’une déception, d’une colère et du détachement de ne pouvoir arrêter l’instant qui passe, fuyant déjà ; et ce, quelle que soit la perception d’une vibration, sa beauté. Une quête d’émancipation, moments fragiles que nous voulons oublier, mais qui continue à nous hanter. Seul l’apprentissage d’un nouveau langage par le mouvement, fera disparaître l’immobilité tremblante de l’attachement aux maîtres. Dévoilé par une série de secousses, l’événement lent d’une respiration n’est rien si vous ne bougez pas, une femme n’est pas une femme si elle n’est pas libre, si elle ne fait pas soi l’étranger intime de soi, le soi intime de l’étranger.
L’héroïne de Catherine Lacey, Elyria, pouvait l’admettre maintenant, elle avait envie d’être responsable de la destruction de son mari, d’une petite à moyenne partie de lui, c’est-à-dire de quelqu’un qui vous aime, même si nous ne voyons pas sous l’éclairage de la lampe torche, cet affreux désir dormir sous les couvertures de l’amour, de l’attachement avec lesquels nous tentons d’étouffer cet atroce désir :
« Chacun rêve d’être indispensable à quelqu’un au point que s’il devait se soustraire à la personne qui a besoin de lui, cela laisserait la personne si vide qu’elle deviendrait complètement inutile, incapable d’être au monde d’une manière normale. »
« Personne ne disparaît » n’est pas un livre sur l’importance des mots mais sur la sonorité des sentiments, comme si l’important en somme n’était pas le goût du café que l’on vous sert, mais l’ondulation que celui-ci fait à la surface de la tasse quand vous l’avez entre les mains. Quoi que vous fassiez, vous n’y pouvez rien, incapable de trouver un moyen d’être, ne cherchant pas non plus une sortie, une entrée dans ce monde, mais tout simplement une preuve de soi-même !
« Cela faisait un moment que je marchais quand j’ai réalisé que je ne marchais plus, mais que j’étais allongée sur le dos, au bord d’un sentier… tombée dans ce territoire proche du coma, entre veille et sommeil, et mes pensées se sont éteintes et j’ai dit, Au revoir, pensées, au revoir, au revoir, et j’étais rempli de sons à la place de pensées, le vent peignait les branches des arbres. Cris et crépitement des parties les plus mortes des bois. Tressaillements des parties les plus vivantes… En fin de compte, j’étais de nouveau en marche et le chemin s’est terminé au bord d’une route goudronnée, et au bout d’un moment une femme au volant d’un van bleu s’est arrêté et a descendu sa vitre… Je n’avais même pas le pouce tendu… J’ai dit, je suis Elyria, et puis on ne s’est plus parlé… »
Qu’est-ce que l’on aimerait rencontrer Catherine Lacey, en tomber peut-être même amoureux, tel un marque-pages qui se retrouve ainsi au milieu de nulle part dans la dissolution des pages, dans l’introspection de sa vie, pour se dépeupler de soi-même !
« Est-ce que mon mari continuerait d’exister ? Et où irait tout le moi qu’il avait abrité en lui si je n’étais pas là pour être avec lui et voir ce qu’il gardait de moi en lui, est-ce que les versions de chacun de nous que nous avions si exactement et si précisément confectionnées pour l’autre, est-ce que ces versions allaient tout simplement s’évaporer, mourir, disparaître, ou juste tomber de l’immeuble pour atterrir quelque part dans chacun de nos cerveaux et si oui, alors pourquoi on n’avait pas le droit de leur organiser des funérailles ? J’aimai le « lui » qu’il avait été pour moi. Je l’aimais et il est mort et je veux un moment triste pour cet homme. Donnez-moi un moment triste pour ça. »
Un éblouissement, qui force à l’amaurose de son image dans la société moderne pour ne vivre que dans sa mémoire forcément voyageuse, intemporel, rythmé par la sonorité des gens, des néons, du chagrin, de la perte et de la destruction. Comme pour seule expérience humaine, celle du chaos d’un être cassable. Très vite, on est ému par cette jeune femme encombrée d’une souffrance indicible, d’une violence dont elle n’a pas les mots, à moins que les mots ne servent qu’à se raconter des histoires et à en écouter celles des autres. À l’écoute de la puissance du bruit inaudible où voyagent tous les désirs des sentiments véritables, des sentiments inavouables.
Mais à quel moment faut-il, ne faut-il plus écouter le monde ?
« Je commençais à comprendre que ce que je voulais, c’était le bruit des autres vivant autour de moi, mais pas suffisamment près pour provoquer l’apparition de bruits inaudibles, parce que je savais désormais que ce genre de bruits se muait souvent en accords mineurs inaudibles et que je suis incapable d’affronter cette mue – quand l’amour ou la gentillesse ou les bruits inaudibles se transforment en ennui ou en déception ou en accord mineur – et c’est la différence entre moi et le reste du monde : la plupart des gens peuvent laisser leurs sentiments changer sans qu’un yack les dévaste à l’intérieur, mais moi, pour une raison ou pour une autre, j’en suis incapable – et quand même, je suis plus humaine que yack, alors je ne serai jamais tout à fait exempte du très humain besoin d’avoir des gens pas loin, mais à cause de ma part yack, il ne faut pas qu’ils soient trop près, et pour ça, je voudrais m’excuser mais je ne peux pas m’excuser pour ça, pas auprès de tous ceux qui méritent des excuses, à moins que personne ne mérite rien, auquel cas, quel soulagement, parce que, ce rien, je peux l’offrir à tout le monde – je peux leur offrir rien à longueur de journée. »
Comment vivre alors avec ce besoin de désir, qui est responsable de sa maltraitance quand son absence, jusqu’au seuil de la tolérance, grignote jusqu’au vide, l’ombre sombre de notre sang ?
« Quitter mon mari sans un mot et errer dans ce pays pendant si longtemps. J’étais simplement là, recroquevillée dans mon rien. Tout ce que je pouvais dire pour expliquer mes piètres choix c’est que j’avais eu le sentiment général d’avoir besoin de partir, d’avoir besoin d’être la première à partir, le besoin de me barricader contre la vie que tous semblaient vivre, la manière apparemment évidente, intuitive, claire et facile et claire pour tous ceux qui n’étaient pas moi, pour tous ceux qui se trouvaient de l’autre côté de cet endroit appelé moi. »
Partir,
pour ne jamais revenir,
comme pour vivre non plus sur la route,
mais dans l’asphalte même,
la perte de soi.
Suppression de la réalité
d’un monde qui pue
qui colle aux basques
au soleil brûlant de la solitude
et de l’égoïsme.
Irréalité figurée d’une liberté
de celle qui cherche à retrouver la terre
de son être premier.
Sa terre,
envahie d’un exil radical.
Qui a dit qu’il ne fallait pas aimer la complexité, la folie ?
De toute façon, on n’a qu’une vie !
(« Personne ne disparaît » de Catherine Lacey, éditions Actes Sud, traduit de l’anglais (USA) par Myriam Anderson, sortie février 2016, 272 pages, 22€)