La présentation de ce roman le rapproche du « Parrain ». Le lien est d’autant plus incontestable que l’on pourrait aussi faire au livre le reproche – ce sera le seul – qui a été fait au film de Coppola : la nostalgie de ce « monde perdu » charrie forcément un discours ambigu sur le gangstérisme et ses figures. Les personnages – y compris les pires – sortent un peu « blanchis » du récit, la poétisation romanesque jouant le rôle d’une absolution des méchants. Malgré la mise à distance à laquelle procède Lehane par l’ironie qui s’insère dans les propos des personnages.
« On décide de notre façon de vivre, on établit nos règles, on se comporte en hommes. (il se pencha en avant.) Ça me botte d’être un gangster, merde ! »
« Je n’ai jamais gagné honnêtement un seul dollar, et je n’ai pas l’intention de commencer un jour ».
Quelle virtuosité narrative Dennis Lehane ! Il nous offre une œuvre qui, d’entrée, va se placer dans les classiques du roman de gangsters. On visite ainsi le musée du genre : personnages dévorés par leur propre cruauté, règlements de comptes sanguinolents, femmes fatales et fascinantes, hommes politiques véreux et prêts à tout pour réussir. Le « cliché » ici n’est pas un défaut. L’écriture serrée de Lehane lui donne une élégance, une noblesse qui en font des images intemporelles.
Car c’est là le projet profond de ce livre, l’intemporalité. Ce « monde perdu » ne se situe pas : il va de la Tragédie Grecque aux romans noirs d’aujourd’hui. Joe Coughlin est le héros, marqué par le sceau du Destin, traversé par les aspirations les plus nobles – il déborde d’amour pour son jeune fils Tomas – et les pulsions les plus noires, les plus ignobles. Schizophrène, comme la plupart des malfrats : capables du pire sadisme et dégoulinants de propos mielleux en toute occasion intime ou mondaine.
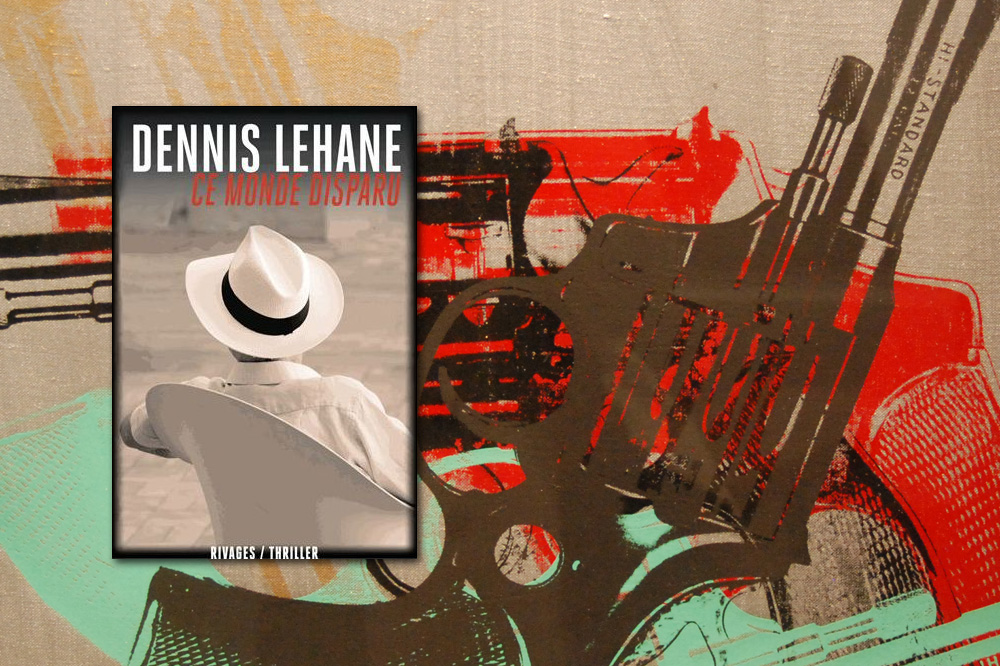
Les gangsters ne peuvent pas ne pas être malades. Psychiquement atteints. Lehane décortique la psychose à l’œuvre, la programmation fatale qui mène ces hommes au pire, comme une glissade tragique qui efface peu à peu les frontières du bien et du mal. Et au bout, toute limite ayant été dépassée, la rédemption est impossible. Joe Coughlin – dont on perçoit clairement la dimension lumineuse – est inéluctablement pris dans l’engrenage du mal, sans retour possible. Lehane est imprégné de la tragédie antique, mais aussi de l’univers shakespearien. Coughlin est poursuivi par un fantôme, sous les traits d’un jeune garçon blond qui sans cesse apparaît à sa vue, dans des lieux imprévisibles. Son père, comme Hamlet ? « Mais pourquoi son père se montrerait-il ainsi ? Même petit, Joe en était presque sûr, Thomas Coughlin devait déjà avoir l’air d’un adulte ». Lui-même avant le mal ? Les ombres tournent et oppressent, reflets terribles de l’Enfer dans lequel Joe s’est enfermé à jamais. Figures du Destin, de la fatalité.
« Lorsque le jeune garçon était apparu à la porte de son bureau, il lui avait semblé que ses traits étaient plus distincts que lors de leurs précédentes rencontres. Il lui avait même trouvé un air de famille : il avait la mâchoire allongée des Coughlin et leurs petites oreilles. S’il s’était tourné vers lui à ce moment-là, Joe n’aurait pas été surpris de reconnaître le visage de son père. »
Dennis Lehane nous offre un roman magistral, remarquablement servi par la traduction d’Isabelle Maillet.
(« Ce monde disparu » de Dennis Lehane, éditions Rivages/thriller, traduit de l’américain par Isabelle Maillet, sortie octobre 2015, 348 pages, 21€)





