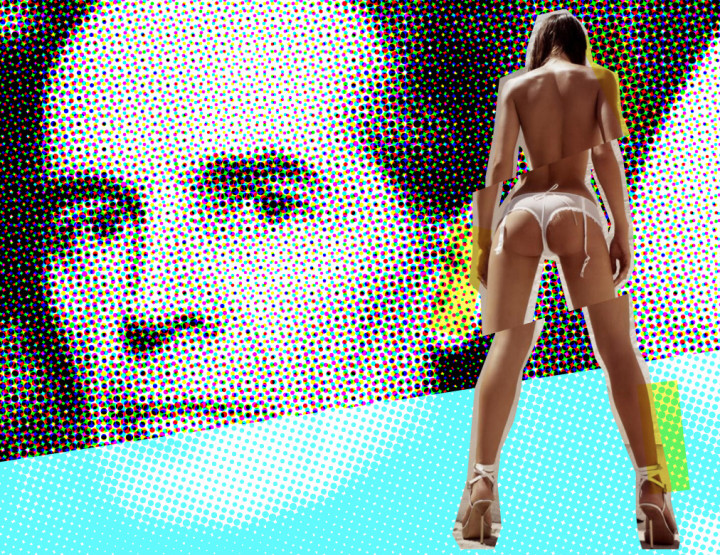« Le jour où l’un de nous arrive sans une histoire à raconter, l’autre est tenu de le quitter sur-le-champ, sans explication, sans regret, sans retour. D’accord ? »
Comme si la fiction avait ouvert les grilles des cages, du mur de l’enceinte pour mieux émerger, « ivres de mots, sans les draps qui étaient le camp de base », de belles histoires. L’histoire d’une rencontre dans les plis de la guérison, dans le lit de la vie. Certes vivant en amoureux de passage il y en eût, des étoiles filantes, les « vrais décevants », les magnifiques, les transparents suffocant dans la vaste mer de l’oubli, qui certains soirs dans son cortège d’ombres, « donne la nausée avec ses balancements incessants, son écume noire, ses phosphorescences glauques ».
« Quelle importance que je le trompe ici ou là, puisque je le trompe ? », questionne le livre de Jean-Marie Laclavetine.
Comme une présence passagère, telle une feuille de papier sur la serrure de nos faiblesses, nos jeux d’adolescents savourant le Je dans les yeux de la conquête facile, aux rebondissements multiples, aux sentiments d’abandon.
Comme une évidence de l’amour, tant désiré, au possible de toutes les libertés, de tous les territoires, inattendue et sublime par les histoires inventées.
« Tu penses à quoi ? »
À un conte des mille et une nuits, à deux nuits, écrit à deux mains, à tour de rôle ou chaque partie du jour éclairé par les néons artificiels, par des courbes et des graphiques, résume ton existence désormais Julia. « Julia, tu penses à quoi ? À moi, à nous ? Je veux que ces histoires te réveillent, qu’elles te parlent de nous si fort que tu ouvres les yeux… Où cela s’arrêtera-t-il ? Où allons-nous vivre, Julia, si les cloisons s’effondrent entre les fictions et si le réel n’est plus capable de se faire reconnaître ? »
Jean-Marie Laclavetine signe un texte intime sur le sentiment amoureux, ou le mensonge, le secret est notre langue commune, un sentiment d’être au monde. Un moment d’abandon à l’autre où l’âme permet au corps de se donner complètement à l’être aimé, jusqu’à non pas se sentir prisonnier mais comme attaché à une autre partie de soi-même. Celui par lequel il nous arrive parfois d’avoir envie de ne plus voir la nuit blanche et noire quand le cœur n’a pas su trouver le trésor qui était en lui, c’est-à-dire l’amour de l’autre. L’amour qui rend humble et ne nécessitant rien d’autre que le regard de celle ou de celui que l’on aime et qui parfois est éclairé par les seuls reflets de l’acier d’un lit anonyme et froid.
Mais qui permet au narrateur, Marco, dans la solitude de la nuit, de raconter l’amoureux dévasté qui visite sa maîtresse en cachette à l’hôpital, d’inventer des histoires pour repousser la mort, pour que l’amour vive encore, pour que la vie, le récit de chaque histoire, construit comme des nouvelles, s’imbrique dans le plus profond de nous-mêmes en « un vrai roman, un de plus, et les infirmières attendries d’écraser une larme. Si elles savaient… »
L’attachement serait-il ce long fleuve de l’âme sœur, d’un bonheur humide, une goutte de rosée de chaque instant, qui mélangée aux souffles mêlés des chaos du torrent furieux, une respiration à chaque temps des correspondances, profondément enfoui sous la peau de nos territoires endormis ? Si tu savais ce que…
« Qu’est-ce qui t’a pris de venir vers moi ce soir-là ? Qu’est-ce qui t’a pris, mon cœur ? Étais-je à ce point séduisant ? Je ne peux le croire… Alors quoi. L’Amour ? L’Amour, d’emblée, dès le premier regard, l’amour comme un invincible aimant ? J’ai su tout de suite. C’était toi. Mais l’amour ce n’est cela, c’est une foudre à combustion lente, un éclair qui se déploie au ralenti dans le ciel plombé de la solitude et qui met des semaines parfois des années à répandre sa lumière sur sa conscience, laquelle devra attendre encore longtemps avant d’être secouée par les roulements terribles du tonnerre… C’était toi… »
Ce beau roman est comme une fleur bleue sur le cœur, un texte qui vous pénètre l’âme avec évidence, comme si une place lui était réservée de toute éternité, depuis le premier regard, le premier toucher, d’une main tendue vers l’extérieur de l’inconfort. Balance instable des sentiments, dans le va-et-vient du sang, entre l’attachement et l’arrachement, entre les signes et les mots, entre le muscle et la raison et qui inexorablement s’achemine vers une mort certaine, quand la raison de vivre n’est plus alimentée par la seule joie des souvenirs, par la seule vision des visages qui ne sont plus et qui n’ont peut-être jamais existé !
« Une boule se formait au niveau de mon plexus, dure et brûlante, je perdais le souffle, mon cœur se mettait à battre irrégulièrement… Je dégringolais dans le trou noir de ton absence… Ton silence était un pays glacial, une toundra de nuit et de vent où mon imagination roulait et sautait comme une boule de chardons sur la plaine du Baragan. Je l’explorais en gémissant, incapable de faire sortir de vraies phrases de ma gorge gelée, incapable de me rendre à la raison, laissant monter en moi le désespoir et la furie plutôt que d’écouter la voix qui me disait : non, elle ne t’a pas abandonné, elle ne t’oublie pas, elle est là, elle se tait pour vous préserver, pour faire une pause dans le flux obsédant des messages, pour ne pas que ton angoisse rompe les digues et emporte tout. J’arpentais ton silence, Julia, découvrant à chaque pas l’étendue de ma solitude. »
C’est chose faite.
Si tu savais…
Un combat entre plaisir et jouissance,
Entre le récit des histoires et l’histoire des tremblements.
« Comme tout le monde j’ai passé ma vie à chercher ma demeure.
Je tournais en rond dans la nuit, guettant une lumière,
une fenêtre allumée.
J’entrais alors,
mais ce n’était jamais le bon endroit.
Tout ce que j’ai vécu,
chaque amour,
chaque épreuve,
chaque expérience,
me conduisait vers toi. »
En disparaissant,
Les êtres parfois vous sauvent,
« Il a fallu que je revienne…
Les gens manquent de foi. »
Tout est bien qui ne finit pas…
(« Et j’ai su que ce trésor était pour moi » de Jean-Marie Laclavetine, éditions Gallimard, coll. Blanche, sortie janvier 2016, 288 pages, 19€)